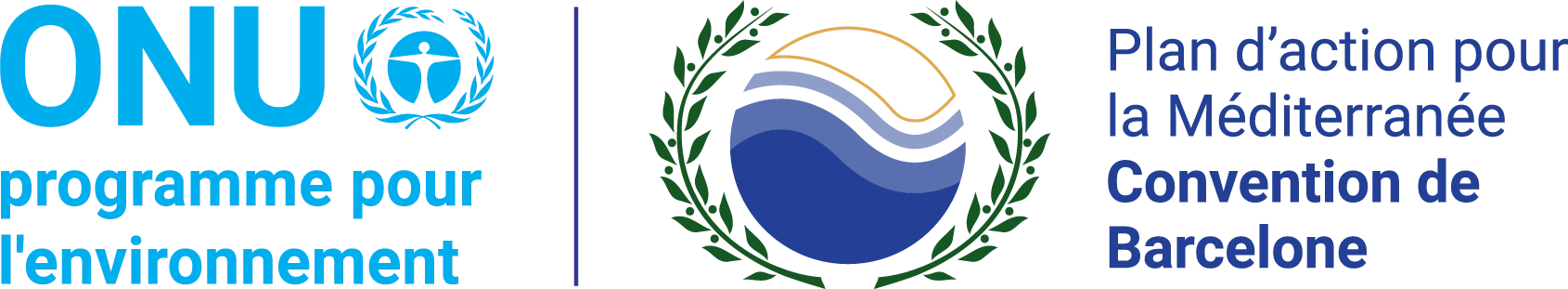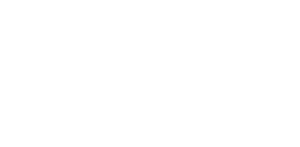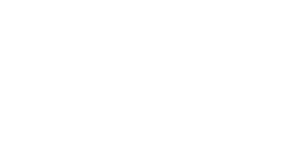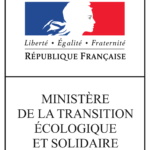Réinventer le tourisme méditerranéen : concilier développement économique, enjeux de conservation et adaptation au changement climatique
Pourquoi repenser le tourisme en Méditerranée ?
Le tourisme constitue l’un des principaux moteurs économiques du pourtour méditerranéen. Dans certains pays du sud et de l’est, comme la Croatie, il peut représenter jusqu’à 25 % du PIB. On estime qu’il génère environ 12,3 millions d’emplois dans les zones littorales, soit près de 11,5 % de l’emploi total dans la région. Pourtant, ce secteur dynamique fait face à des pressions environnementales croissantes, à une dépendance aux énergies fossiles et à une vulnérabilité aiguë face aux chocs climatiques, géopolitiques et sanitaires. Face à l’accélération des impacts du changement climatique et à l’impératif de la transition écologique, repenser et adapter le secteur du tourisme s’impose aujourd’hui comme une nécessité.
La pandémie de Covid-19 a mis en lumière cette fragilité : fermeture soudaine des frontières, perte de revenus pour les territoires dépendants du tourisme international, impact direct sur les professionnels locaux. Si la crise a fait émerger une réflexion sur des modèles plus durables et résilients, le retour rapide aux tendances d’avant-crise montre que le changement structurel reste à concrétiser. Dans plusieurs régions, les niveaux de fréquentation ont déjà retrouvé, voire dépassé, ceux de 2019, sans véritable transformation du modèle dominant.
Tourisme en Méditerranée : entre pressions multiples et défis d’adaptation
Le développement touristique exerce une pression croissante sur les littoraux méditerranéens. L’urbanisation accrue des zones côtières, souvent irréversible, grignote les espaces naturels fragiles et accentue l’érosion. Les activités liées au tourisme (hébergement, croisières, plaisance, transports) sont également à l’origine de pollutions multiples : émissions de gaz à effet de serre, rejets d’eaux usées, déchets plastiques, bruit sous-marin, congestion routière, qui impactent directement la qualité des écosystèmes, la biodiversité marine et terrestre, ainsi que la santé et le bien-être des populations locales. Ces pressions sont exacerbées par la forte saisonnalité des flux, la concentration géographique des touristes, et la faible diversification des offres dans certaines zones.
Face à ces défis, le Plan Bleu plaide pour une adaptation systémique du tourisme méditerranéen. Cela passe par une révision en profondeur des modèles d’aménagement, une meilleure gestion des ressources naturelles, l’implication des acteurs locaux, et le renforcement des capacités à planifier, anticiper et s’adapter collectivement aux risques à venir.
Le rôle du Plan Bleu : indicateurs, outils et projets pilotes
Pour soutenir cette transition, le Plan Bleu développe des outils de suivi et d’aide à la décision en lien avec les politiques publiques de tourisme durable. Il coordonne et participe à des projets territoriaux, apporte un appui technique aux collectivités et diffuse des solutions concrètes issues de collaborations régionales. Le rapport « État des lieux du tourisme en Méditerranée » (2022) offre une base actualisée pour comprendre les dynamiques post-Covid, et les opportunités d’action.
Le catalogue des bonnes pratiques produit dans le cadre de la Communauté Tourisme Durable Interreg-MED regroupe des exemples inspirants : systèmes d’éco labellisation (comme le Pavillon Bleu), gestion durable des ports de plaisance, suivi environnemental des zones côtières, limitation des flux, diversification de l’offre vers l’écotourisme ou le tourisme culturel hors-saison. Ces démarches, encore trop souvent marginales, peuvent constituer le socle d’un changement d’échelle.
Le Plan Bleu valorise et anime aussi de nombreuses initiatives territoriales qui mettent en œuvre ces principes. Le projet Adapt’Pelagos explore les conditions d’une plaisance plus respectueuse des cétacés dans le sanctuaire du même nom. Le projet NaTour4ClimateChange renforce les capacités d’adaptation touristique dans les Aires Marines Protégées. Le projet CASadapt aide les territoires côtiers du sud à intégrer l’adaptation dans la planification touristique. Autant de démarches co-construites avec les acteurs locaux, les chercheurs et les gestionnaires d’aires protégées.
Recommandations pour un tourisme plus résilient
Pour ancrer durablement la transition du secteur, le Plan Bleu propose des orientations politiques claires : mieux intégrer le tourisme dans les plans d’adaptation climatiques, renforcer la gouvernance intersectorielle, soutenir financièrement les acteurs de terrain dans leurs transitions, et valoriser les approches participatives. Former les professionnels, mobiliser les citoyens, renforcer la collecte d’indicateurs de durabilité et les dispositifs d’observation sont autant de leviers clés identifiés dans les publications du Plan Bleu.