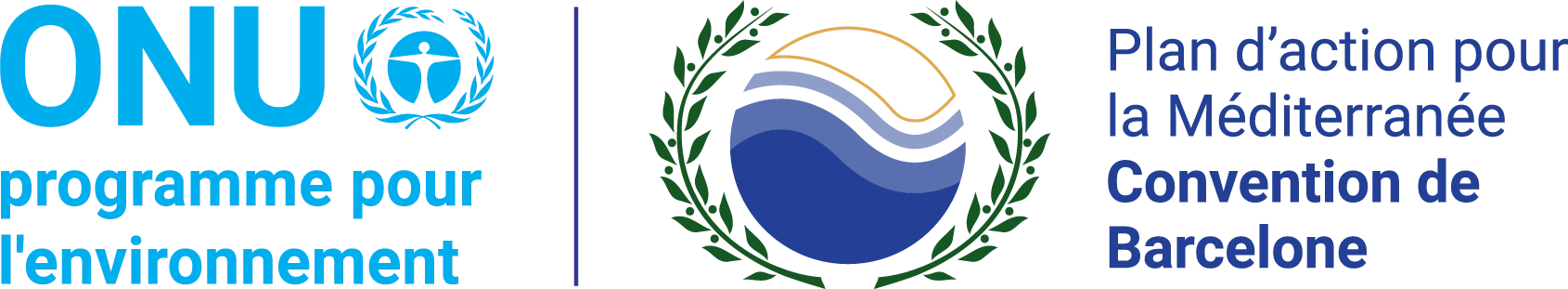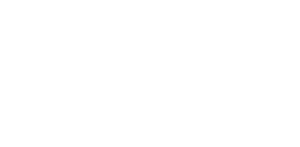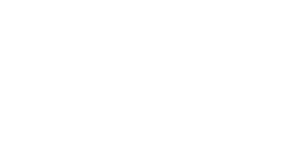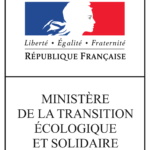Compte tenu des pressions climatiques et anthropiques accrues sur les ressources en eau en Méditerranée, une gestion intégrée de ces ressources fondée sur la gestion de la demande en eau est absolument vitale.
Des ressources en eau inégalement réparties et des pressions croissantes
Les réservoirs naturels hydriques sont répartis de façon hétérogène à l’échelle du bassin. Trois pays, la France, l’Italie et la Türkiye reçoivent, à eux seuls, la moitié du total des précipitations, tandis que les pays du Sud n’en capitalisent qu’un dixième. Dans certains pays comme l’Égypte, Israël ou Malte, les prélèvements en eau avoisinent ou excèdent le volume annuel moyen de ressources naturelles renouvelables (indice supérieur à 80 %).
Les projections prévoient que les tensions sur l’eau devraient s’aggraver d’ici 2050 avec une demande en eau de plus en plus forte et une empreinte saisonnière marquée. Des évolutions significatives en termes de croissance démographique au Sud et à l’Est, de développement du tourisme, de l’industrie et des terres irriguées, ainsi que les impacts du changement climatique vont exacerber ces pressions sur la ressource hydrique méditerranéenne.
Selon les études et projections modèles existantes, les populations méditerranéennes « pauvres en eau », sous le seuil de 1000 m³ par habitant par an (stress hydrique), devraient passer de 180 millions de personnes aujourd’hui à plus de 250 millions dans les 20 ans.
Alternative : agir sur la demande en eau et pas uniquement sur l’offre
Avec l’accroissement rapide de la population, la dégradation de l’environnement et les effets du changement climatique, les Méditerranéens s’adaptent en favorisant le développement des ressources en eau non conventionnelles (REUT et dessalement), pratiques encore aujourd’hui très controversées. Il n’est aujourd’hui plus possible de satisfaire l’ensemble des demandes en eau en augmentant l’offre, qui a constitué la réponse traditionnelle des politiques de l’eau en Méditerranée.
Face à cette situation de crise, un vaste champ de progrès concerne la gestion de la ressource, notamment en jouant sur la demande en eau, sa distribution et ses usages. Cela consiste à réduire les pertes et les mauvaises utilisations (gaspillages, fuites lors de la distribution ou du transport) ainsi qu’à améliorer l’efficience de l’utilisation de la ressource. Les marges de progrès sont considérables : le potentiel d’économies d’eau a été évalué à 25 % de la demande, l’agriculture irriguée représentant plus de 65 % de ce potentiel.
Programmation « Eau » 2025–2027 du Plan Bleu
Les activités visent à appuyer la mise en œuvre de la Stratégie Méditerranéenne pour le Développement Durable (SMDD) et, plus spécifiquement, à aider les pays méditerranéens à garantir la sécurité en eau face aux changements globaux. Elles se structurent autour de quatre différents axes stratégiques. L’Observatoire du Plan Bleu permet de suivre les évolutions quantitatives/qualitatives de la ressource en eau. L’objectif est de soutenir et promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau en partageant le savoir et l’information aux parties prenantes méditerranéennes.
Proposer des analyses sectorielles intégrant la ressource en eau, au travers de la SMDD, des différents rapports thématiques sur le tourisme, l’industrie et l’agriculture.
De plus, les travaux scientifiques du MedECC et les études orientées sur les Solutions Fondées sur la Nature (SfNs) mettent en exergue les impacts du changement climatique sur la ressource ainsi que des solutions d’adaptation et d’atténuation de ces derniers. Enfin, le Plan Bleu explore toujours les perspectives techno-solutionnistes (de plus en plus répandues sur le bassin), comme le dessalement et la réutilisation des eaux usées. Au regard de l’essor de ces secteurs d’activités, il est crucial de se questionner sur leur durabilité.
-
Favoriser l’échange d’informations et la collecte de données par l’Observatoire du Plan Bleu.
-
Promouvoir la durabilité des ressources en eau non conventionnelles.